|
 Compte-rendu
du voyage au Sahara de novembre 2007, rédigé par
Bruno Barrillot pour la revue Damoclès
(à
lire impérativement) Compte-rendu
du voyage au Sahara de novembre 2007, rédigé par
Bruno Barrillot pour la revue Damoclès
(à
lire impérativement)
« Du
13 au 19 novembre 2007,
Bruno
Barrillot a eu l’occasion d’accompagner une équipe
de télévision française à Reggane1,
au coeur du Sahara algérien où, entre 1960 et 1961
eurent lieu les premiers essais nucléaires atmosphériques
français. Inutile de dire que leur présence à
Reggane n’est guère passée inaperçue !
... »
Compte-rendu
du voyage au Sahara de février 2008
Dimanche
dix février, il était quatorze heures quand le
taxi-brousse au départ d’Adrar nous a déposés
sur la place centrale de Reggane. Nous avons réalisé
que, désormais, nous n'étions plus des inconnus
dans cette bourgade. A peine les pieds posés sur le sable
de Reggane, nous étions déjà repérés.
Les gens se rappelaient de nous, ils venaient nous saluer, nous
souhaiter la bienvenue et s’enquérir de nos
nouvelles depuis notre dernière visite.
 En
nous rendant à notre hébergement pour prendre
possession de nos chambres et déposer notre barda, voilà
que par le plus pur des hasards, nous sommes tombés nez à
nez avec un officier de police; lui aussi nous a salué
chaleureusement . Après nous avoir souhaité la
bienvenue à Reggane, il nous a posé quelques
questions sur notre présence dans la ville. Finalement, il
nous a demandé à jeter un coup d'oeil sur nos
passeports, puis il a griffonné sur un papier, nos numéros
de passeports, les dates d’entrée au pays et le
numéro de visa d’Hervé. Nous étions
partis d’Alger la veille, pour arriver très tard à
Adrar, par un vol de nuit. J’avais dormi durant tout le
vol, jusqu’à ce que l’impact du train
d’atterrissage sur le tarmac ne me tire de ma torpeur. Il
faisait un froid de canard. Nous avions ensuite attendu plus
d’une heure à l’aéroport qu’un
taxi daigne montrer le bout de son nez pour que l’on puisse
se rendre à l'hôtel. La faim, le froid et la fatigue
avaient fini par avoir raison de la patience d’Hervé.
Normal il n’était qu’à son deuxième
voyage en Algérie, et l’Algérie et plus
particulièrement le Sahara ça se mérite.
Pour les apprécier, il faut savoir être zen, et
surtout faire la rupture avec le stress des mégalopoles
françaises. Nous sommes à deux heures seulement de
Paris, et c’est déjà une autre planète.
Le Sahara est l’une des plus belles régions que je
connaisse ! En
nous rendant à notre hébergement pour prendre
possession de nos chambres et déposer notre barda, voilà
que par le plus pur des hasards, nous sommes tombés nez à
nez avec un officier de police; lui aussi nous a salué
chaleureusement . Après nous avoir souhaité la
bienvenue à Reggane, il nous a posé quelques
questions sur notre présence dans la ville. Finalement, il
nous a demandé à jeter un coup d'oeil sur nos
passeports, puis il a griffonné sur un papier, nos numéros
de passeports, les dates d’entrée au pays et le
numéro de visa d’Hervé. Nous étions
partis d’Alger la veille, pour arriver très tard à
Adrar, par un vol de nuit. J’avais dormi durant tout le
vol, jusqu’à ce que l’impact du train
d’atterrissage sur le tarmac ne me tire de ma torpeur. Il
faisait un froid de canard. Nous avions ensuite attendu plus
d’une heure à l’aéroport qu’un
taxi daigne montrer le bout de son nez pour que l’on puisse
se rendre à l'hôtel. La faim, le froid et la fatigue
avaient fini par avoir raison de la patience d’Hervé.
Normal il n’était qu’à son deuxième
voyage en Algérie, et l’Algérie et plus
particulièrement le Sahara ça se mérite.
Pour les apprécier, il faut savoir être zen, et
surtout faire la rupture avec le stress des mégalopoles
françaises. Nous sommes à deux heures seulement de
Paris, et c’est déjà une autre planète.
Le Sahara est l’une des plus belles régions que je
connaisse !
 Oubliés
la faim, le froid et la fatigue, Hervé s’est
réveillé tôt et de bonne humeur. Il m’a
précédé pour prendre le petit déjeuner,
je l’ai rejoint dans un café situé dans une
palmeraie, juste en face de l’hôtel. Avant même
que je lui dise bonjour, il m’a lancé, sur un ton
quasi théâtral : « ce lieu est
magnifique, c’est un vrai bonheur, tu ne trouves pas? ».
Moi j’avais surtout hâte de m’envoyer un grand
thé à la menthe derrière la cravate. Ensuite
nous avons fait un tour dans le centre ville où j’ai
acheté quelques paires de chaussettes pour la durée
du séjour. Notre destination finale c’était
Reggane, deux heures de route depuis Adrar et il fallait nous
dépêcher, car si nous tardions trop, nous risquions
de faire le trajet dans la canicule. Après des
négociations rondement menées avec le « taxieur »
comme on dit ici, nous avons pris place à coté du
chauffeur, car Hervé ne voulais absolument pas monter
derrière. Son argument est imparable, derrière, en
cas d’accident, m’expliquait-il, la désincarcération
est très difficile. Oubliés
la faim, le froid et la fatigue, Hervé s’est
réveillé tôt et de bonne humeur. Il m’a
précédé pour prendre le petit déjeuner,
je l’ai rejoint dans un café situé dans une
palmeraie, juste en face de l’hôtel. Avant même
que je lui dise bonjour, il m’a lancé, sur un ton
quasi théâtral : « ce lieu est
magnifique, c’est un vrai bonheur, tu ne trouves pas? ».
Moi j’avais surtout hâte de m’envoyer un grand
thé à la menthe derrière la cravate. Ensuite
nous avons fait un tour dans le centre ville où j’ai
acheté quelques paires de chaussettes pour la durée
du séjour. Notre destination finale c’était
Reggane, deux heures de route depuis Adrar et il fallait nous
dépêcher, car si nous tardions trop, nous risquions
de faire le trajet dans la canicule. Après des
négociations rondement menées avec le « taxieur »
comme on dit ici, nous avons pris place à coté du
chauffeur, car Hervé ne voulais absolument pas monter
derrière. Son argument est imparable, derrière, en
cas d’accident, m’expliquait-il, la désincarcération
est très difficile.
A Reggane, nous avons d’abord
pris possession de nos chambres, et pendant que Hervé
« checkait » la caméra, j’ai
jeté un oeil sur le planning de la semaine, et j'ai
commencé par donner quelques coups de téléphone
pour « bétonner » la suite…
La dernière fois que nous avions tourné à
Hamoudia, nous avions été constamment escortés
par les gendarmes et par l’armée, Cette fois, à
part le policier rencontré à notre arrivée,
notre présence ne semblait émouvoir personne, et
tant mieux, c’est ainsi qu’on est à l’aise
pour bosser.
Nous avons attaqué notre
tournage dès le lundi matin, par les prises de vue
aériennes. C'était la première fois de ma
vie que je survolais le Sahara à bord d’un
hélicoptère. Nous avons survolé, à
basse altitude, la base vie d’Hamoudia, puis le champ de
tir avec ses quatre points zéro. Ensuite, nous avons
réalisé plusieurs survols de Reggane ville et des
palmeraies environnantes. J’ai découvert une autre
ville, je ne soupçonnais pas Reggane aussi vert !
 Quand
je pense au discours de Jules Moch du 5 novembre 1959 devant
l’assemblée générale des nations
unies, présentant Reggane comme futur Centre
d’Expérimentations Atomiques, parce que, disait-il
alors, c’est un lieu où il n’y a aucune vie
animale et végétale… Ce monsieur a perdu une
belle occasion de se taire, parce que dans cette vallée du
Touat, l’eau coule à flot et les palmeraies et les
jardins sont d’un beau vert très vif. On y cultive
les palmiers, mais aussi des tomates, des poivrons, des céréales,
des patates et toutes sortes de choses, et cela, grâce au
système ancestral et ingénieux des fougarates, qui
permet une vie végétale riche et abondante. Je
connaissais déjà Hamoudia et son champ de tir, on
s’y était rendu par route, avec Hervé
Portanguen et Bruno Barrillot lors de notre premier voyage, en
novembre 2007. Mais l’observation depuis le ciel change
tout, elle donne l’impression de découvrir un autre
endroit. La vision verticale tranche avec la vue à
l’horizontale, elle induit une perception inédite de
l’espace. Jamais l’expression « prendre de
la hauteur » ne m’a semblé aussi juste.
Je me suis rendu compte combien cette parcelle de désert
était immense, et combien le désastre était
grand ! Partout des taches noires souillent le sable ocre et
pur. D’ici j’avais une vision universelle du drame.
Le fait d’avoir bénéficié d’un
double point de vue, terrestre et céleste, renforce la
lecture du désastre et donne de l’éloquence
au regard. Pendant ce survol, j’ai pensé à
l’expression du copilote du B52 américain qui a
largué la bombe sur Hiroshima. De son cockpit, en
regardant l’apocalypse provoquée par la première
bombe atomique de l’histoire, il s’est écrié :
« mon dieu qu’avons-nous fait? ».
Aujourd’hui aussi, on peut s’interroger : mais
qu’a-t-elle donc fait aux hommes cette parcelle de Sahara,
ce bout de terre nu, pour qu’on lui inocule ce poison, la
rendant ainsi malade pour l’éternité, la
transformant en lieu malsain ? Lors de notre première
visite, nous étions accompagnés par l’expert
Bruno Barrillot, il avait avec lui un petit compteur Geiger de la
CRIIRAD. A peine posé sur le sable vitrifié,
l’appareil s'était mis à cracher au maximum,
« il est complètement saturé, l’endroit
est contaminé pour plusieurs milliers d’années »
m'avait alors dit l’expert ! Quand
je pense au discours de Jules Moch du 5 novembre 1959 devant
l’assemblée générale des nations
unies, présentant Reggane comme futur Centre
d’Expérimentations Atomiques, parce que, disait-il
alors, c’est un lieu où il n’y a aucune vie
animale et végétale… Ce monsieur a perdu une
belle occasion de se taire, parce que dans cette vallée du
Touat, l’eau coule à flot et les palmeraies et les
jardins sont d’un beau vert très vif. On y cultive
les palmiers, mais aussi des tomates, des poivrons, des céréales,
des patates et toutes sortes de choses, et cela, grâce au
système ancestral et ingénieux des fougarates, qui
permet une vie végétale riche et abondante. Je
connaissais déjà Hamoudia et son champ de tir, on
s’y était rendu par route, avec Hervé
Portanguen et Bruno Barrillot lors de notre premier voyage, en
novembre 2007. Mais l’observation depuis le ciel change
tout, elle donne l’impression de découvrir un autre
endroit. La vision verticale tranche avec la vue à
l’horizontale, elle induit une perception inédite de
l’espace. Jamais l’expression « prendre de
la hauteur » ne m’a semblé aussi juste.
Je me suis rendu compte combien cette parcelle de désert
était immense, et combien le désastre était
grand ! Partout des taches noires souillent le sable ocre et
pur. D’ici j’avais une vision universelle du drame.
Le fait d’avoir bénéficié d’un
double point de vue, terrestre et céleste, renforce la
lecture du désastre et donne de l’éloquence
au regard. Pendant ce survol, j’ai pensé à
l’expression du copilote du B52 américain qui a
largué la bombe sur Hiroshima. De son cockpit, en
regardant l’apocalypse provoquée par la première
bombe atomique de l’histoire, il s’est écrié :
« mon dieu qu’avons-nous fait? ».
Aujourd’hui aussi, on peut s’interroger : mais
qu’a-t-elle donc fait aux hommes cette parcelle de Sahara,
ce bout de terre nu, pour qu’on lui inocule ce poison, la
rendant ainsi malade pour l’éternité, la
transformant en lieu malsain ? Lors de notre première
visite, nous étions accompagnés par l’expert
Bruno Barrillot, il avait avec lui un petit compteur Geiger de la
CRIIRAD. A peine posé sur le sable vitrifié,
l’appareil s'était mis à cracher au maximum,
« il est complètement saturé, l’endroit
est contaminé pour plusieurs milliers d’années »
m'avait alors dit l’expert !
Le
reste de la semaine, nous l'avons consacré à la
collecte de témoignages de la population de Reggane et des
environs et au filmage de séquences pour enrichir le
récit.
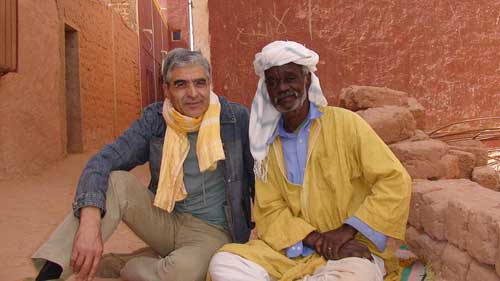 Entre
la fin des années cinquante et jusqu'en 1966, beaucoup de
gens venus de l'ensemble du Touat et du Tassili ont travaillé
comme manoeuvres sur les deux sites des essais. Aujourd'hui, ils
sont rares, beaucoup d'entre eux sont décédés,
seulement une poignée vit encore. Je suis allé à
leur recherche, j'en ai rencontré quelques uns, les
témoignages sont poignants. Selon eux, les vestiges encore
visibles des essais atomiques ne sont que la partie visible de
l'iceberg atomique saharien. En effet, après les essais,
avant de quitter le Sahara pour le Pacifique, l'armée
française aurait enfoui sur place tout le matériel
contaminé et inutilisable. Certains d'entre eux ont été
employés par ladite armée française pour
ramasser le matériel résultant des essais
(ferraille, restes d'engins, câbles électriques et
objets divers…). Ils les ont ramassés à
mains nues et sans protection particulière, m'ont-ils
affirmé. Ces déchets étaient-ils radioactifs
? La question demeure posée ! Tout ce qu'ils ramassaient
était enfoui dans le sable par les engins du génie
militaire. En ce qui concerne cette question de l'enfouissement
de déchets technologiques, les témoignages
collectés aussi bien en France qu'en Algérie
concordent. Certains vétérans exhibent des preuves
photographiques, montrant des avions disloqués prêt
à être balancés dans des cavités
creusées dans le sable. Ainsi donc, on n'a pas seulement
pollué la surface de la terre, ses entrailles aussi ont
été contaminées. L'état dans lequel
se trouve ce bout de Sahara constitue une terrible métaphore
de l'état de santé des vétérans,
atteints eux aussi par les mêmes éléments
radioactifs qui les rongent de l'intérieur ! En quittant
le Sahara pour le Pacifique, l'armée française n'a
pas pris le soin de sécuriser le site, ni de le
débarrasser des produits dangereux et récupérables.
Alors ce qui devait arriver arriva. Des trafiquants de métaux
ont flairé les bénéfices qu'ils pouvaient
tirer d'une telle situation. Ils sont alors arrivés de
Béchar, m'a-t-on dit, ils ont recruté des gens
d'ici et des environs pour déterrer et récupérer
de la ferraille et des câbles électriques qu'on
brûlait sur place pour les dégainer. Le tout était
alors chargé sur des camions, pour une destination que
seuls les trafiquants connaissaient. Le trafic aurait duré
plusieurs années. Selon ces témoins, le cuivre
probablement radioactif aurait été revendu à
des artisans marocains, qui le transformeraient en bijoux et
autres objets pour touristes… D'après un
instituteur à la retraite que j'ai rencontré,
aujourd'hui encore on trouve chez des gens des objets provenant
du centre des essais atomiques d'Hamoudia… Entre
la fin des années cinquante et jusqu'en 1966, beaucoup de
gens venus de l'ensemble du Touat et du Tassili ont travaillé
comme manoeuvres sur les deux sites des essais. Aujourd'hui, ils
sont rares, beaucoup d'entre eux sont décédés,
seulement une poignée vit encore. Je suis allé à
leur recherche, j'en ai rencontré quelques uns, les
témoignages sont poignants. Selon eux, les vestiges encore
visibles des essais atomiques ne sont que la partie visible de
l'iceberg atomique saharien. En effet, après les essais,
avant de quitter le Sahara pour le Pacifique, l'armée
française aurait enfoui sur place tout le matériel
contaminé et inutilisable. Certains d'entre eux ont été
employés par ladite armée française pour
ramasser le matériel résultant des essais
(ferraille, restes d'engins, câbles électriques et
objets divers…). Ils les ont ramassés à
mains nues et sans protection particulière, m'ont-ils
affirmé. Ces déchets étaient-ils radioactifs
? La question demeure posée ! Tout ce qu'ils ramassaient
était enfoui dans le sable par les engins du génie
militaire. En ce qui concerne cette question de l'enfouissement
de déchets technologiques, les témoignages
collectés aussi bien en France qu'en Algérie
concordent. Certains vétérans exhibent des preuves
photographiques, montrant des avions disloqués prêt
à être balancés dans des cavités
creusées dans le sable. Ainsi donc, on n'a pas seulement
pollué la surface de la terre, ses entrailles aussi ont
été contaminées. L'état dans lequel
se trouve ce bout de Sahara constitue une terrible métaphore
de l'état de santé des vétérans,
atteints eux aussi par les mêmes éléments
radioactifs qui les rongent de l'intérieur ! En quittant
le Sahara pour le Pacifique, l'armée française n'a
pas pris le soin de sécuriser le site, ni de le
débarrasser des produits dangereux et récupérables.
Alors ce qui devait arriver arriva. Des trafiquants de métaux
ont flairé les bénéfices qu'ils pouvaient
tirer d'une telle situation. Ils sont alors arrivés de
Béchar, m'a-t-on dit, ils ont recruté des gens
d'ici et des environs pour déterrer et récupérer
de la ferraille et des câbles électriques qu'on
brûlait sur place pour les dégainer. Le tout était
alors chargé sur des camions, pour une destination que
seuls les trafiquants connaissaient. Le trafic aurait duré
plusieurs années. Selon ces témoins, le cuivre
probablement radioactif aurait été revendu à
des artisans marocains, qui le transformeraient en bijoux et
autres objets pour touristes… D'après un
instituteur à la retraite que j'ai rencontré,
aujourd'hui encore on trouve chez des gens des objets provenant
du centre des essais atomiques d'Hamoudia…
 Quant
aux explosions nucléaires proprement dites, tous les
Regganis en âge de se souvenir s'en souviennent. Ils les
décrivent dans le menu détail. Ils se souviennent
que la veille des explosions, l'armée leur donnait l'ordre
de quitter leurs maisons au matin à l'heure de la prière.
Ils racontent qu'ils ont d'abord vu un éclair d'une
puissance phénoménale. Puis, quelques minutes
après, la terre a tremblé, suivit aussitôt
d'un grondement de tonnerre qui a fait lever un vent de sable,
puis plus rien. Beaucoup d'entre eux disent avoir aperçu
des avions traverser le nuage de la bombe. Mohamed Dadda est un
ancien P.L.O. (Population Laborieuse des Oasis), il habite à
Aoulef, et a longtemps travaillé sur le site d'Hamoudia,
il était manoeuvre sur le chantier qui construisait les
plate-formes des pylônes qui portaient les bombes.
Aujourd'hui, Mohamed Dadda est handicapé, il parle
difficilement et a perdu l'usage de ses pieds. Pour lui, il ne
fait aucun doute, son infirmité est due à sa
présence lors du tir de Gerboise bleue le 13 février
1960. Il m'a affirmé qu'il faisait partie du groupe de
P.L.O. qui a été disposé, disait-il, entre
la bombe et un groupe de soldats. Comme il a des problèmes
d'élocution, pour bien me faire comprendre le sens de ce
qu'il me disait, il a esquissé un croquis dans le sable...
L'accusation est grave, si elle s'avère vraie, alors c'est
un crime. Un autre habitant d'Aoulef affirme que les explosions
atomiques ont provoqué l'effondrement de certaines
fougarates. Quant
aux explosions nucléaires proprement dites, tous les
Regganis en âge de se souvenir s'en souviennent. Ils les
décrivent dans le menu détail. Ils se souviennent
que la veille des explosions, l'armée leur donnait l'ordre
de quitter leurs maisons au matin à l'heure de la prière.
Ils racontent qu'ils ont d'abord vu un éclair d'une
puissance phénoménale. Puis, quelques minutes
après, la terre a tremblé, suivit aussitôt
d'un grondement de tonnerre qui a fait lever un vent de sable,
puis plus rien. Beaucoup d'entre eux disent avoir aperçu
des avions traverser le nuage de la bombe. Mohamed Dadda est un
ancien P.L.O. (Population Laborieuse des Oasis), il habite à
Aoulef, et a longtemps travaillé sur le site d'Hamoudia,
il était manoeuvre sur le chantier qui construisait les
plate-formes des pylônes qui portaient les bombes.
Aujourd'hui, Mohamed Dadda est handicapé, il parle
difficilement et a perdu l'usage de ses pieds. Pour lui, il ne
fait aucun doute, son infirmité est due à sa
présence lors du tir de Gerboise bleue le 13 février
1960. Il m'a affirmé qu'il faisait partie du groupe de
P.L.O. qui a été disposé, disait-il, entre
la bombe et un groupe de soldats. Comme il a des problèmes
d'élocution, pour bien me faire comprendre le sens de ce
qu'il me disait, il a esquissé un croquis dans le sable...
L'accusation est grave, si elle s'avère vraie, alors c'est
un crime. Un autre habitant d'Aoulef affirme que les explosions
atomiques ont provoqué l'effondrement de certaines
fougarates.
 Aujourd'hui,
le problème principal concerne la manière dont la
fermeture de ces sites a été gérée et
l'absence de suivi sanitaire. En effet, comment se fait-il qu'en
partant, l'armée française n'ait rien fait, même
pas le minimum, c'est-à-dire, à défaut de
décontaminer, au moins sécuriser l'endroit.
Pourquoi, quarante-six ans après, n'a-t-on toujours pas
réalisé une enquête épidémiologique
auprès de la population du Touat et évalué
les effets des essais sur l'environnement ? Aujourd'hui,
le problème principal concerne la manière dont la
fermeture de ces sites a été gérée et
l'absence de suivi sanitaire. En effet, comment se fait-il qu'en
partant, l'armée française n'ait rien fait, même
pas le minimum, c'est-à-dire, à défaut de
décontaminer, au moins sécuriser l'endroit.
Pourquoi, quarante-six ans après, n'a-t-on toujours pas
réalisé une enquête épidémiologique
auprès de la population du Touat et évalué
les effets des essais sur l'environnement ?
N'est-il pas urgent de procéder
à une inspection et à une évaluation des
risques en ce qui concerne les matériaux récupérés
par des personnes sur les sites des essais ? Enfin, l'armée
française doit fournir le relevé des différents
points d'enfouissement afin d'établir un inventaire précis
de tous les endroits à risques, pour que ceux-ci soient
évacués et leurs déchets stockés dans
un seul centre d'enfouissement. Ce sont des précautions
élémentaires, mais urgentes.
Zaglou est une petite localité,
située sur la route d'Adrar, c'est là que j'ai
rencontré deux anciens P.L.O. qui ont travaillé sur
les points de tir de Gerboise bleue et blanche, ils ont aussi
assisté à leurs explosions. Ma demande les laisse
perplexe, parce que c'est la première fois que quelqu'un
sollicite leurs témoignages. Ils racontent : "Le
matin de bonne heure, les militaires nous ont transportés
en camion dans un endroit dans le Tanezrouft, ils nous ont
disposés par petits groupes de trois personnes chacun,
nous étions derrière une dune, ensuite ils nous ont
distribué des gris gris (dosimètres) que nous avons
mis autour du cou. Puis ils nous ont dit de nous coucher sur le
sable et de nous couvrir les yeux avec les mains. On a été
secoué par la lumière et le bruit de l'explosion,
le sol a tremblé et un nuage de sable s'est élevé.
J'avais l'impression que la fin du monde était arrivée.
Certains parmi nous ont eu si peur, qu'ils ont fui à
travers le Tanezrouft, ils ne sont plus revenus pour travailler
sur les chantiers. Puis, le nuage de la bombe s'est élevé
dans le ciel, il était beau avec des couleurs changeantes,
nous avons vu des avions le traverser de part en part pour le
pousser à aller vers le Soudan ».
Parmi les personnes que j'ai
rencontrées, rares sont celles qui sont déjà
retournées à Hamoudia, et quand je leur ai demandé
les raisons de cette abstinence, tous ont invoqué la peur
de la bombe, qu'ils appellent « El Ghoula »
(l'ogresse). Ici, la bombe a non seulement fait des dégâts
physiques, véritables et vérifiables, mais elle a
aussi imprégné l'imaginaire collectif. Dans
l'esprit de tous les Regganis, la bombe est l'origine de tous les
maux. C'est elle qui a engendré la maladie du palmier,
c'est aussi elle qui apporté les maladies comme les
cancers, le trachome, l'hypertension et les malformations, ou
encore la baisse du rendement agricole et la rareté de
l'eau… Un travail de réhabilitation c'est aussi
retrouver un imaginaire collectif sain, débarrassé
des fantasmes engendrés par le manque d'information. Dès
le début de cette aventure, les promoteurs de la bombe ne
se sont intéressés qu'à l'espace, pas à
la population qui le peuple. Personne n'est venu expliquer à
la population que la région avait été
choisie comme site pour opérer des expérimentations
atomiques, en lui exposant clairement les risques et en lui
donnant des consignes de sécurité, en construisant
des abris anti-atomiques comme on l'a fait, plus tard, pour les
populations du Pacifique. Pourquoi ne leur a-t-on pas distribué
des dosimètres au même titre que la population
française présente à Reggane à cette
époque ? Jusqu'à l'heure actuelle, on n’a
jamais fait oeuvre de pédagogie par l’organisation
de conférences, d'expositions, d'entretiens, d'écrits
expliquant les tenants et les aboutissants des essais par rapport
à la population et à l'environnement. Les gens
n'ont été consultés ni en amont ni en aval,
il est donc tout à fait naturel, qu'en l'absence de
transparence et d'information, les gens développent ce
type de fantasmes.
Récemment, le gouvernement
algérien a décidé de sécuriser les
environs de Gerboise bleue, l'entourage grillagé est en
cours de réalisation. C'est une bonne chose, mais ce n'est
pas suffisant, on l'a vu sur le site d'In Eker, la clôture
a été défoncée à plusieurs
endroits. Si les sites ne sont pas véritablement
sécurisés, une simple clôture n'arrête
pas les intrusions.
C'est mon troisième séjour
sur les sites atomiques sahariens. J'ai également
rencontré beaucoup de personnes s'intéressant, à
des titres divers, à cette question. Je commence donc à
avoir une vision précise et pragmatique de la
problématique. J'ai la conviction qu'il est urgent de
désigner une commission composée de scientifiques
français et algériens pour qu'ils se mettent au
travail et réfléchissent ensemble à un
véritable programme de suivi sanitaire, à la mise
en place d'un processus de sécurisation, de
décontamination et de réhabilitation des sites
zones touchées par les essais.
L. B.
|


 En
nous rendant à notre hébergement pour prendre
possession de nos chambres et déposer notre barda, voilà
que par le plus pur des hasards, nous sommes tombés nez à
nez avec un officier de police; lui aussi nous a salué
chaleureusement . Après nous avoir souhaité la
bienvenue à Reggane, il nous a posé quelques
questions sur notre présence dans la ville. Finalement, il
nous a demandé à jeter un coup d'oeil sur nos
passeports, puis il a griffonné sur un papier, nos numéros
de passeports, les dates d’entrée au pays et le
numéro de visa d’Hervé. Nous étions
partis d’Alger la veille, pour arriver très tard à
Adrar, par un vol de nuit. J’avais dormi durant tout le
vol, jusqu’à ce que l’impact du train
d’atterrissage sur le tarmac ne me tire de ma torpeur. Il
faisait un froid de canard. Nous avions ensuite attendu plus
d’une heure à l’aéroport qu’un
taxi daigne montrer le bout de son nez pour que l’on puisse
se rendre à l'hôtel. La faim, le froid et la fatigue
avaient fini par avoir raison de la patience d’Hervé.
Normal il n’était qu’à son deuxième
voyage en Algérie, et l’Algérie et plus
particulièrement le Sahara ça se mérite.
Pour les apprécier, il faut savoir être zen, et
surtout faire la rupture avec le stress des mégalopoles
françaises. Nous sommes à deux heures seulement de
Paris, et c’est déjà une autre planète.
Le Sahara est l’une des plus belles régions que je
connaisse !
En
nous rendant à notre hébergement pour prendre
possession de nos chambres et déposer notre barda, voilà
que par le plus pur des hasards, nous sommes tombés nez à
nez avec un officier de police; lui aussi nous a salué
chaleureusement . Après nous avoir souhaité la
bienvenue à Reggane, il nous a posé quelques
questions sur notre présence dans la ville. Finalement, il
nous a demandé à jeter un coup d'oeil sur nos
passeports, puis il a griffonné sur un papier, nos numéros
de passeports, les dates d’entrée au pays et le
numéro de visa d’Hervé. Nous étions
partis d’Alger la veille, pour arriver très tard à
Adrar, par un vol de nuit. J’avais dormi durant tout le
vol, jusqu’à ce que l’impact du train
d’atterrissage sur le tarmac ne me tire de ma torpeur. Il
faisait un froid de canard. Nous avions ensuite attendu plus
d’une heure à l’aéroport qu’un
taxi daigne montrer le bout de son nez pour que l’on puisse
se rendre à l'hôtel. La faim, le froid et la fatigue
avaient fini par avoir raison de la patience d’Hervé.
Normal il n’était qu’à son deuxième
voyage en Algérie, et l’Algérie et plus
particulièrement le Sahara ça se mérite.
Pour les apprécier, il faut savoir être zen, et
surtout faire la rupture avec le stress des mégalopoles
françaises. Nous sommes à deux heures seulement de
Paris, et c’est déjà une autre planète.
Le Sahara est l’une des plus belles régions que je
connaisse !
 Oubliés
la faim, le froid et la fatigue, Hervé s’est
réveillé tôt et de bonne humeur. Il m’a
précédé pour prendre le petit déjeuner,
je l’ai rejoint dans un café situé dans une
palmeraie, juste en face de l’hôtel. Avant même
que je lui dise bonjour, il m’a lancé, sur un ton
quasi théâtral : « ce lieu est
magnifique, c’est un vrai bonheur, tu ne trouves pas? ».
Moi j’avais surtout hâte de m’envoyer un grand
thé à la menthe derrière la cravate. Ensuite
nous avons fait un tour dans le centre ville où j’ai
acheté quelques paires de chaussettes pour la durée
du séjour. Notre destination finale c’était
Reggane, deux heures de route depuis Adrar et il fallait nous
dépêcher, car si nous tardions trop, nous risquions
de faire le trajet dans la canicule. Après des
négociations rondement menées avec le « taxieur »
comme on dit ici, nous avons pris place à coté du
chauffeur, car Hervé ne voulais absolument pas monter
derrière. Son argument est imparable, derrière, en
cas d’accident, m’expliquait-il, la désincarcération
est très difficile.
Oubliés
la faim, le froid et la fatigue, Hervé s’est
réveillé tôt et de bonne humeur. Il m’a
précédé pour prendre le petit déjeuner,
je l’ai rejoint dans un café situé dans une
palmeraie, juste en face de l’hôtel. Avant même
que je lui dise bonjour, il m’a lancé, sur un ton
quasi théâtral : « ce lieu est
magnifique, c’est un vrai bonheur, tu ne trouves pas? ».
Moi j’avais surtout hâte de m’envoyer un grand
thé à la menthe derrière la cravate. Ensuite
nous avons fait un tour dans le centre ville où j’ai
acheté quelques paires de chaussettes pour la durée
du séjour. Notre destination finale c’était
Reggane, deux heures de route depuis Adrar et il fallait nous
dépêcher, car si nous tardions trop, nous risquions
de faire le trajet dans la canicule. Après des
négociations rondement menées avec le « taxieur »
comme on dit ici, nous avons pris place à coté du
chauffeur, car Hervé ne voulais absolument pas monter
derrière. Son argument est imparable, derrière, en
cas d’accident, m’expliquait-il, la désincarcération
est très difficile.
 Quand
je pense au discours de Jules Moch du 5 novembre 1959 devant
l’assemblée générale des nations
unies, présentant Reggane comme futur Centre
d’Expérimentations Atomiques, parce que, disait-il
alors, c’est un lieu où il n’y a aucune vie
animale et végétale… Ce monsieur a perdu une
belle occasion de se taire, parce que dans cette vallée du
Touat, l’eau coule à flot et les palmeraies et les
jardins sont d’un beau vert très vif. On y cultive
les palmiers, mais aussi des tomates, des poivrons, des céréales,
des patates et toutes sortes de choses, et cela, grâce au
système ancestral et ingénieux des fougarates, qui
permet une vie végétale riche et abondante. Je
connaissais déjà Hamoudia et son champ de tir, on
s’y était rendu par route, avec Hervé
Portanguen et Bruno Barrillot lors de notre premier voyage, en
novembre 2007. Mais l’observation depuis le ciel change
tout, elle donne l’impression de découvrir un autre
endroit. La vision verticale tranche avec la vue à
l’horizontale, elle induit une perception inédite de
l’espace. Jamais l’expression « prendre de
la hauteur » ne m’a semblé aussi juste.
Je me suis rendu compte combien cette parcelle de désert
était immense, et combien le désastre était
grand ! Partout des taches noires souillent le sable ocre et
pur. D’ici j’avais une vision universelle du drame.
Le fait d’avoir bénéficié d’un
double point de vue, terrestre et céleste, renforce la
lecture du désastre et donne de l’éloquence
au regard. Pendant ce survol, j’ai pensé à
l’expression du copilote du B52 américain qui a
largué la bombe sur Hiroshima. De son cockpit, en
regardant l’apocalypse provoquée par la première
bombe atomique de l’histoire, il s’est écrié :
« mon dieu qu’avons-nous fait? ».
Aujourd’hui aussi, on peut s’interroger : mais
qu’a-t-elle donc fait aux hommes cette parcelle de Sahara,
ce bout de terre nu, pour qu’on lui inocule ce poison, la
rendant ainsi malade pour l’éternité, la
transformant en lieu malsain ? Lors de notre première
visite, nous étions accompagnés par l’expert
Bruno Barrillot, il avait avec lui un petit compteur Geiger de la
CRIIRAD. A peine posé sur le sable vitrifié,
l’appareil s'était mis à cracher au maximum,
« il est complètement saturé, l’endroit
est contaminé pour plusieurs milliers d’années »
m'avait alors dit l’expert !
Quand
je pense au discours de Jules Moch du 5 novembre 1959 devant
l’assemblée générale des nations
unies, présentant Reggane comme futur Centre
d’Expérimentations Atomiques, parce que, disait-il
alors, c’est un lieu où il n’y a aucune vie
animale et végétale… Ce monsieur a perdu une
belle occasion de se taire, parce que dans cette vallée du
Touat, l’eau coule à flot et les palmeraies et les
jardins sont d’un beau vert très vif. On y cultive
les palmiers, mais aussi des tomates, des poivrons, des céréales,
des patates et toutes sortes de choses, et cela, grâce au
système ancestral et ingénieux des fougarates, qui
permet une vie végétale riche et abondante. Je
connaissais déjà Hamoudia et son champ de tir, on
s’y était rendu par route, avec Hervé
Portanguen et Bruno Barrillot lors de notre premier voyage, en
novembre 2007. Mais l’observation depuis le ciel change
tout, elle donne l’impression de découvrir un autre
endroit. La vision verticale tranche avec la vue à
l’horizontale, elle induit une perception inédite de
l’espace. Jamais l’expression « prendre de
la hauteur » ne m’a semblé aussi juste.
Je me suis rendu compte combien cette parcelle de désert
était immense, et combien le désastre était
grand ! Partout des taches noires souillent le sable ocre et
pur. D’ici j’avais une vision universelle du drame.
Le fait d’avoir bénéficié d’un
double point de vue, terrestre et céleste, renforce la
lecture du désastre et donne de l’éloquence
au regard. Pendant ce survol, j’ai pensé à
l’expression du copilote du B52 américain qui a
largué la bombe sur Hiroshima. De son cockpit, en
regardant l’apocalypse provoquée par la première
bombe atomique de l’histoire, il s’est écrié :
« mon dieu qu’avons-nous fait? ».
Aujourd’hui aussi, on peut s’interroger : mais
qu’a-t-elle donc fait aux hommes cette parcelle de Sahara,
ce bout de terre nu, pour qu’on lui inocule ce poison, la
rendant ainsi malade pour l’éternité, la
transformant en lieu malsain ? Lors de notre première
visite, nous étions accompagnés par l’expert
Bruno Barrillot, il avait avec lui un petit compteur Geiger de la
CRIIRAD. A peine posé sur le sable vitrifié,
l’appareil s'était mis à cracher au maximum,
« il est complètement saturé, l’endroit
est contaminé pour plusieurs milliers d’années »
m'avait alors dit l’expert !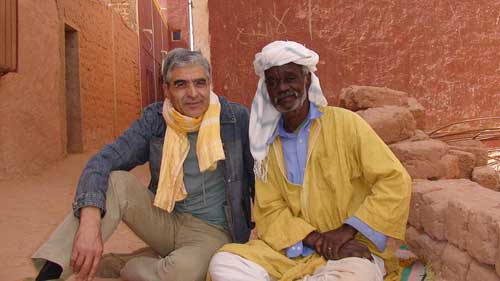 Entre
la fin des années cinquante et jusqu'en 1966, beaucoup de
gens venus de l'ensemble du Touat et du Tassili ont travaillé
comme manoeuvres sur les deux sites des essais. Aujourd'hui, ils
sont rares, beaucoup d'entre eux sont décédés,
seulement une poignée vit encore. Je suis allé à
leur recherche, j'en ai rencontré quelques uns, les
témoignages sont poignants. Selon eux, les vestiges encore
visibles des essais atomiques ne sont que la partie visible de
l'iceberg atomique saharien. En effet, après les essais,
avant de quitter le Sahara pour le Pacifique, l'armée
française aurait enfoui sur place tout le matériel
contaminé et inutilisable. Certains d'entre eux ont été
employés par ladite armée française pour
ramasser le matériel résultant des essais
(ferraille, restes d'engins, câbles électriques et
objets divers…). Ils les ont ramassés à
mains nues et sans protection particulière, m'ont-ils
affirmé. Ces déchets étaient-ils radioactifs
? La question demeure posée ! Tout ce qu'ils ramassaient
était enfoui dans le sable par les engins du génie
militaire. En ce qui concerne cette question de l'enfouissement
de déchets technologiques, les témoignages
collectés aussi bien en France qu'en Algérie
concordent. Certains vétérans exhibent des preuves
photographiques, montrant des avions disloqués prêt
à être balancés dans des cavités
creusées dans le sable. Ainsi donc, on n'a pas seulement
pollué la surface de la terre, ses entrailles aussi ont
été contaminées. L'état dans lequel
se trouve ce bout de Sahara constitue une terrible métaphore
de l'état de santé des vétérans,
atteints eux aussi par les mêmes éléments
radioactifs qui les rongent de l'intérieur ! En quittant
le Sahara pour le Pacifique, l'armée française n'a
pas pris le soin de sécuriser le site, ni de le
débarrasser des produits dangereux et récupérables.
Alors ce qui devait arriver arriva. Des trafiquants de métaux
ont flairé les bénéfices qu'ils pouvaient
tirer d'une telle situation. Ils sont alors arrivés de
Béchar, m'a-t-on dit, ils ont recruté des gens
d'ici et des environs pour déterrer et récupérer
de la ferraille et des câbles électriques qu'on
brûlait sur place pour les dégainer. Le tout était
alors chargé sur des camions, pour une destination que
seuls les trafiquants connaissaient. Le trafic aurait duré
plusieurs années. Selon ces témoins, le cuivre
probablement radioactif aurait été revendu à
des artisans marocains, qui le transformeraient en bijoux et
autres objets pour touristes… D'après un
instituteur à la retraite que j'ai rencontré,
aujourd'hui encore on trouve chez des gens des objets provenant
du centre des essais atomiques d'Hamoudia…
Entre
la fin des années cinquante et jusqu'en 1966, beaucoup de
gens venus de l'ensemble du Touat et du Tassili ont travaillé
comme manoeuvres sur les deux sites des essais. Aujourd'hui, ils
sont rares, beaucoup d'entre eux sont décédés,
seulement une poignée vit encore. Je suis allé à
leur recherche, j'en ai rencontré quelques uns, les
témoignages sont poignants. Selon eux, les vestiges encore
visibles des essais atomiques ne sont que la partie visible de
l'iceberg atomique saharien. En effet, après les essais,
avant de quitter le Sahara pour le Pacifique, l'armée
française aurait enfoui sur place tout le matériel
contaminé et inutilisable. Certains d'entre eux ont été
employés par ladite armée française pour
ramasser le matériel résultant des essais
(ferraille, restes d'engins, câbles électriques et
objets divers…). Ils les ont ramassés à
mains nues et sans protection particulière, m'ont-ils
affirmé. Ces déchets étaient-ils radioactifs
? La question demeure posée ! Tout ce qu'ils ramassaient
était enfoui dans le sable par les engins du génie
militaire. En ce qui concerne cette question de l'enfouissement
de déchets technologiques, les témoignages
collectés aussi bien en France qu'en Algérie
concordent. Certains vétérans exhibent des preuves
photographiques, montrant des avions disloqués prêt
à être balancés dans des cavités
creusées dans le sable. Ainsi donc, on n'a pas seulement
pollué la surface de la terre, ses entrailles aussi ont
été contaminées. L'état dans lequel
se trouve ce bout de Sahara constitue une terrible métaphore
de l'état de santé des vétérans,
atteints eux aussi par les mêmes éléments
radioactifs qui les rongent de l'intérieur ! En quittant
le Sahara pour le Pacifique, l'armée française n'a
pas pris le soin de sécuriser le site, ni de le
débarrasser des produits dangereux et récupérables.
Alors ce qui devait arriver arriva. Des trafiquants de métaux
ont flairé les bénéfices qu'ils pouvaient
tirer d'une telle situation. Ils sont alors arrivés de
Béchar, m'a-t-on dit, ils ont recruté des gens
d'ici et des environs pour déterrer et récupérer
de la ferraille et des câbles électriques qu'on
brûlait sur place pour les dégainer. Le tout était
alors chargé sur des camions, pour une destination que
seuls les trafiquants connaissaient. Le trafic aurait duré
plusieurs années. Selon ces témoins, le cuivre
probablement radioactif aurait été revendu à
des artisans marocains, qui le transformeraient en bijoux et
autres objets pour touristes… D'après un
instituteur à la retraite que j'ai rencontré,
aujourd'hui encore on trouve chez des gens des objets provenant
du centre des essais atomiques d'Hamoudia…
 Quant
aux explosions nucléaires proprement dites, tous les
Regganis en âge de se souvenir s'en souviennent. Ils les
décrivent dans le menu détail. Ils se souviennent
que la veille des explosions, l'armée leur donnait l'ordre
de quitter leurs maisons au matin à l'heure de la prière.
Ils racontent qu'ils ont d'abord vu un éclair d'une
puissance phénoménale. Puis, quelques minutes
après, la terre a tremblé, suivit aussitôt
d'un grondement de tonnerre qui a fait lever un vent de sable,
puis plus rien. Beaucoup d'entre eux disent avoir aperçu
des avions traverser le nuage de la bombe. Mohamed Dadda est un
ancien P.L.O. (Population Laborieuse des Oasis), il habite à
Aoulef, et a longtemps travaillé sur le site d'Hamoudia,
il était manoeuvre sur le chantier qui construisait les
plate-formes des pylônes qui portaient les bombes.
Aujourd'hui, Mohamed Dadda est handicapé, il parle
difficilement et a perdu l'usage de ses pieds. Pour lui, il ne
fait aucun doute, son infirmité est due à sa
présence lors du tir de Gerboise bleue le 13 février
1960. Il m'a affirmé qu'il faisait partie du groupe de
P.L.O. qui a été disposé, disait-il, entre
la bombe et un groupe de soldats. Comme il a des problèmes
d'élocution, pour bien me faire comprendre le sens de ce
qu'il me disait, il a esquissé un croquis dans le sable...
L'accusation est grave, si elle s'avère vraie, alors c'est
un crime. Un autre habitant d'Aoulef affirme que les explosions
atomiques ont provoqué l'effondrement de certaines
fougarates.
Quant
aux explosions nucléaires proprement dites, tous les
Regganis en âge de se souvenir s'en souviennent. Ils les
décrivent dans le menu détail. Ils se souviennent
que la veille des explosions, l'armée leur donnait l'ordre
de quitter leurs maisons au matin à l'heure de la prière.
Ils racontent qu'ils ont d'abord vu un éclair d'une
puissance phénoménale. Puis, quelques minutes
après, la terre a tremblé, suivit aussitôt
d'un grondement de tonnerre qui a fait lever un vent de sable,
puis plus rien. Beaucoup d'entre eux disent avoir aperçu
des avions traverser le nuage de la bombe. Mohamed Dadda est un
ancien P.L.O. (Population Laborieuse des Oasis), il habite à
Aoulef, et a longtemps travaillé sur le site d'Hamoudia,
il était manoeuvre sur le chantier qui construisait les
plate-formes des pylônes qui portaient les bombes.
Aujourd'hui, Mohamed Dadda est handicapé, il parle
difficilement et a perdu l'usage de ses pieds. Pour lui, il ne
fait aucun doute, son infirmité est due à sa
présence lors du tir de Gerboise bleue le 13 février
1960. Il m'a affirmé qu'il faisait partie du groupe de
P.L.O. qui a été disposé, disait-il, entre
la bombe et un groupe de soldats. Comme il a des problèmes
d'élocution, pour bien me faire comprendre le sens de ce
qu'il me disait, il a esquissé un croquis dans le sable...
L'accusation est grave, si elle s'avère vraie, alors c'est
un crime. Un autre habitant d'Aoulef affirme que les explosions
atomiques ont provoqué l'effondrement de certaines
fougarates. Aujourd'hui,
le problème principal concerne la manière dont la
fermeture de ces sites a été gérée et
l'absence de suivi sanitaire. En effet, comment se fait-il qu'en
partant, l'armée française n'ait rien fait, même
pas le minimum, c'est-à-dire, à défaut de
décontaminer, au moins sécuriser l'endroit.
Pourquoi, quarante-six ans après, n'a-t-on toujours pas
réalisé une enquête épidémiologique
auprès de la population du Touat et évalué
les effets des essais sur l'environnement ?
Aujourd'hui,
le problème principal concerne la manière dont la
fermeture de ces sites a été gérée et
l'absence de suivi sanitaire. En effet, comment se fait-il qu'en
partant, l'armée française n'ait rien fait, même
pas le minimum, c'est-à-dire, à défaut de
décontaminer, au moins sécuriser l'endroit.
Pourquoi, quarante-six ans après, n'a-t-on toujours pas
réalisé une enquête épidémiologique
auprès de la population du Touat et évalué
les effets des essais sur l'environnement ?